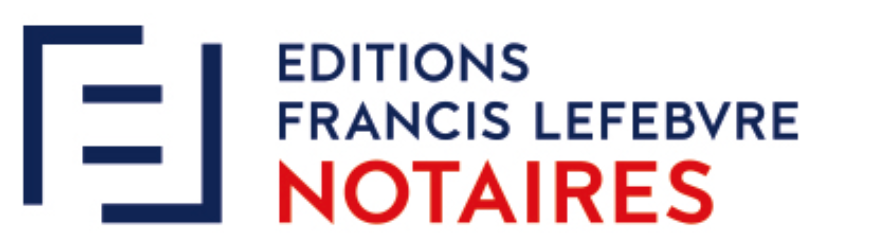Opter pour les placements solidaires, ou comment donner du sens à son épargne
Malgré un engouement en progression continue depuis près de vingt ans, les placements dits "solidaires" demeurent encore confidentiels et les épargnants s'estiment toujours insuffisamment informés. Tour d'horizon des produits qui peuvent leur être proposés et de leur mode de fonctionnement.

Les placements éthiques ou d'utilité sociale ou environnementale continuent de séduire les épargnants français si l'on en croit la dernière livraison en date ؘ– juin 2024 – du baromètre de l'association FAIR, acteur historique de la finance solidaire en France. 2023 fut la troisième meilleure année de collecte depuis 2008, derrière 2020 et 2021, et l'encours global des produits disposant d'un label spécifique a progressé de 15 %, pour atteindre 30 milliards d'euros. L'épargne salariale draine la part la plus importante de la collecte, devant les placements bancaires et d'assurance et l'investissement direct dans les entreprises. Pour autant, l'épargne solidaire représente seulement 0,5 % de l'épargne financière totale des Français et, même si les épargnants continuent de donner un sens vertueux à leurs placements, leur priorité en la matière reste avant tout personnelle. En effet, une enquête Opinion Way pour le compte de Fair, publiée en septembre 2024, indique que la volonté d'épargner de façon sécurisée prime sur l'impact. Ainsi, 33 % des répondants priorisent la disponibilité du capital, 29 %, la sécurité du capital, et 22 %, le rendement financier, tandis que l'impact social et écologique est cité comme premier objectif par uniquement 12 % des épargnants. Par ailleurs, selon la même enquête, près de sept épargnants sur dix s'estiment insuffisamment informés sur les produits d'épargne solidaire. Le besoin d'accompagnement et d'information s'exprime donc encore fortement.
À la différence des placements classiques, les épargnants savent expressément en souscrivant des produits d'épargne solidaire que les sommes collectées servent à soutenir des activités telles que les énergies renouvelables, le développement durable, l'insertion sociale, le logement, l'emploi ou encore la solidarité internationale. Les sommes sont ainsi investies, directement ou indirectement, dans des entreprises et des associations à forte utilité sociale et environnementale.
Les produits d'épargne solidaire se répartissent en deux grandes catégories. On distingue, d'une part, les placements dits "de partage", pour lesquels la solidarité se manifeste par le reversement, sous forme de dons, d'une partie des revenus générés par les placements au profit d'organismes engagés dans une action humanitaire, sociale ou environnementale. D'autre part, l'épargnant peut souscrire à des produits d'investissement solidaire, pour lesquels la solidarité se manifeste par le financement de projets d'utilité sociale et environnementale grâce à tout ou partie des sommes placées sur le produit. Les deux logiques peuvent se combiner pour un même produit d'épargne solidaire.
La fiscalité favorable des placements de partage
Les placements de partage sont essentiellement des fonds, de type SICAV ou FCP, et des livrets d'épargne. Le règlement de ces produits financiers comporte un engagement de reversement de 25 % au moins des revenus (intérêts, dividendes, plus-values) sous forme de dons à des organismes reconnus d'intérêt général engagés dans des actions humanitaires, sociales ou environnementales auxquels ils sont associés.
|
Bon à savoir |
|
Les fonds de partage peuvent être généralistes ou thématiques. Notez qu'ils peuvent être souscrits directement via un compte-titres ordinaire ou dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie. |
Pour l'épargnant, la part des revenus des placements de partage reversée sous forme de dons ouvre droit à la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons aux œuvres et aux organismes d'intérêt général. La réduction est égale à 75 % du montant des versements, retenus dans la limite de 1 000 € s'agissant des dons consentis aux organismes d'aide aux personnes en difficulté. Pour la part des versements aux organismes d'aide aux personnes en difficulté qui dépassent 1 000 € et pour les autres dons, la réduction d'impôt de droit commun s'applique, à savoir 66 % des sommes versées, retenues dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Sauf cas d'exonération (intérêts du livret A ou LDDS, par exemple), la part des revenus reversée sous forme de dons à des organismes d'intérêt général est soumise au niveau de l'épargnant à un prélèvement forfaitaire libératoire obligatoire de 5 %, soit un taux global d'imposition de 22,2 % avec les prélèvements sociaux (CSG + CRDS). Le prélèvement est opéré à la source par l'établissement payeur. Ce taux réduit d'imposition vise uniquement les intérêts et autres revenus fixes. Les revenus ayant une autre nature sont imposés dans les conditions de droit commun (PFU + prélèvements sociaux, au taux global de 30 %).
Les placements d'investissement solidaire bénéficient d'un label
Les placements d'investissement solidaire sont généralement des fonds (SICAV ou FCP), des livrets bancaires, des comptes à terme (d'une durée le plus souvent comprise entre 1 et 7 ans) ou des bons de caisse. L'épargne collectée sur ces placements est investie, selon le cas, en prenant des participations dans des acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS), en leur octroyant des prêts d'honneur, des micro-crédits ou en leur accordant une garantie. Entre 5 % et 10 % de l'encours de chacun des produits d'épargne solidaire est ainsi dédié au financement de l'ESS. Le reste est géré librement, le plus souvent en fonction de critères d'investissement socialement responsable (ISR) notamment via l'investissement dans des fonds ISR.
|
ESS, ISR… explication de texte |
|
Les entités qui œuvrent dans l'économie sociale et solidaire (ESS) – associations, fondations, mutuelles, coopératives, certaines entreprises commerciales – produisent des biens ou des services à forte utilité sociale et/ou environnementale. Elles développent, par exemple, des projets de lutte contre le chômage, l'exclusion ou le mal-logement, de développement de l'agriculture biologique, des énergies renouvelables, ou encore des projets de soutien aux pays en voie de développement (projets concernant la santé, l'alimentation, l'éducation, le commerce équitable, etc.). L'investissement socialement responsable (ISR) est un concept plus large que celui d'épargne solidaire. Les fonds ISR sont constitués par des sociétés de gestion qui sélectionnent les actifs selon l'approche de l'investissement socialement responsable, à savoir selon des critères financiers classiques mais également selon trois critères extra-financiers : l'environnement, le social/sociétal et la gouvernance d'entreprise. |
Les fonds solidaires (SICAV et FCP) sont accessibles via différents supports. Ils peuvent être logés sur un compte-titres, un PEA ou peuvent représenter une unité de compte au sein d'un contrat d'assurance-vie. Il est également possible d'investir dans un fonds solidaire dans le cadre de l'épargne salariale (PEE, PEI, PERECO et PERCO). Pour l'épargnant, s'applique la fiscalité de droit commun propre à chacune de ces formules d'épargne.
Le label Finansol, attribué par un comité d'experts indépendants, permet d'identifier, parmi les produits d'épargne proposés au grand public, ceux qui contribuent au financement d'activités génératrices d'utilité sociale et/ou environnementale. Ces derniers sont sélectionnés selon des critères de solidarité, de transparence et d'information. Pour les fonds solidaires, la partie "investissement classique" doit obligatoirement être ISR pour obtenir le label Finansol. Le label Finansol peut également être attribué à des placements de partage.
Et pourquoi pas la souscription directe au capital de sociétés de l'ESS ?
Plutôt que de souscrire des produits d'épargne qui orientent leurs encours vers l'économie sociale et solidaire, l'épargnant peut choisir d'investir directement en souscrivant au capital de sociétés qui agissent dans ce domaine. Ces sociétés ne sont pas cotées sur les marchés boursiers. L'épargnant devient ainsi associé et peut participer directement à la gestion et à l'orientation des sommes reçues. Dans ce cas de figure, les capitaux sont généralement investis pour cinq années au minimum.
La souscription en numéraire au capital d'une entreprise solidaire agréée "entreprise solidaire d'utilité sociale" (Esus) ouvre droit à la réduction d'impôt pour souscription au capital de PME suivant des modalités spécifiques. En principe égal à 18 %, le taux de la réduction d'impôt est porté à 25 % pour les versements réalisés au titre de la souscription au capital des Esus jusqu'au 31 décembre 2025. Pour obtenir l'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale" (Esus), l'entreprise doit avoir pour objectif principal la recherche d'une utilité sociale (soutien à des publics vulnérables, cohésion territoriale ou développement durable). La charge induite par ses activités d'utilité sociale doit impacter significativement le compte de résultat. La politique de rémunération de l'entreprise doit respecter certains critères.
Les bonnes pratiques avant d'investir
Comme pour toute solution d'épargne, la formule ou le produit choisi ici doit être en adéquation avec ses objectifs personnels, sa sensibilité au risque et son horizon de placement. D'une part, l'épargnant ne doit pas oublier que l'investissement solidaire implique d'abandonner une partie de son intérêt personnel au profit d'autrui ou en vue de soutenir une cause que l'on estime importante. Il convient donc aussi de réfléchir aux actions que l'on souhaite soutenir : préservation de l'environnement, aide aux plus démunis, aide internationale, etc. D'autre part, l'épargne solidaire n'est pas sans risque. L'AMF le rappelle dans ses recommandations : "épargner solidaire ne garantit en rien le capital investi, ni de meilleurs rendements". L'investissement solidaire peut être un moyen parmi d'autres de faire fructifier son épargne, mais parfois à une vitesse moins importante que lors d'un investissement classique.
© Lefebvre Dalloz